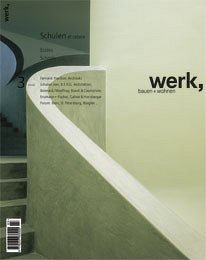Editorial
Editorial
Last autumn there was an account in the newspaper to the effect that the City of Zurich is currently carrying out investigations into public schools to be built and run by private investors. The city authorities were even reported to have already knocked at Coop's door and financed the first studies with the consent of the concern. The model is new and to a large extent unripe, and the current perspectives culminate in the prospect of a private investor building a school on his own ground and at his own cost in Zurich West and subsequently letting it to the city. „Private-public partnership“ is the motto. „Progress reports“ are planned to ensure the controlled course of such a closing of ranks between public resources and private economy; for example, for the Zurich School Project 21, which includes the promotion of English lessons and the use of computers early on in the school curriculum. Will there be a „loser“ in all this? Well, a school is not a football stadium and a school day is not an opera performance. Therefore the state and the city parliament would be letting go of a valuable asset were they negligently to delegate one of their most fundamental state-political cultural responsibilities, the construction and the running of state schools. The „return of investment“ is represented by a well-educated younger generation - and by high-quality buildings meeting their public nature both functionally as well as urbanistically that are realised on the basis of public competitions and should not be left to the whims of private owner-builders. Buildings of this kind are the theme of this „et cetera“ issue. They are distinguishable not only by virtue of their construction but also by the eminent state-economic and political importance of the task. On the one hand, the buildings presented here all resulted from competitions, on the other they represent the successful debut of a number of young teams of architects. The fact that we were able to win some practising architects over to introduce and comment on the schools makes the topic even more interesting and bears witness to the importance attached to the critical building assignment which - it must be repeated - must not be permitted to stray into the hands of isolated private entrepreneurs. The issue ends with a contribution on the French architect Fernand Pouillon who is little known in German-speaking countries despite his considerable standing. An architect and adventurous entrepreneur, it was his entrepreneurship that finally led to his downfall. Nevertheless, his great urban development projects and buildings still evidence outstanding and undisputed quality. The Editors
Inhalt
Thema
Jaques Lucan
Fernand Pouillon: Architekt
Matthias Ackermann
Schlussstein Kantonsschule «Luegeten» in Zug, Enzmann + Fischer, Zürich
Daniel Niggli
«Seid der rosarote Panther!» | Erweiterung der Schule für soziale und pädagogische Studien (EESP)
Bonnard/Woeffray, Monthey
Tibor Joanelly
Expressive Halle, atelierartige Zimmer | Erweiterung Schulhaus Mattenhof, Zürich Schwamendingen B.E.R.G. Architekten, Zürich
Inge Beckel
Sphären der Halböffentlichkeit | Schulhaus in der Höh, Volketswil, Gafner Horisberger, Zürich
Christoph Wieser
Vor Anker im Schweizer Mittelland | Primarschulhaus Linden, Niederhasli, Bünzli & Courvoisier, Zürich
Forum
Kolumne: Wolfgang Ullrich
Wettbewerb: Bärengraben Bern
Innenarchitektur: «Schauküche Cookuk» Aarau
Nachruf: Pierre Zoelly
EFH: Haus zur «Stiege», Bürglen UR, von Loeliger Strub Architektur
Bauten: Dorfbanken
Kolloquium: Urbanität und Identität zeitgenössischer europäischer Städte
Bücher: Stadt und Architektur | Tessiner in Russland | «matières»
Spitzenarchitektur
bauen + rechten
Ausstellungen
Vorträge | Veranstaltungen | Wettbewerbe | Firmennachrichten
Vorschau | Impressum
werk-Material
Michele Arnaboldi, Locarno Bankfiliale in Intragna, TI
Steinmann & Schmid Architekten AG, Basel Wohn- und Geschäftshaus mit Banklokal, VS
Fernand Pouillon: architecte
Pendant longtemps, le nom de Fernand Pouillon (1912-1986) était connu du public français parce qu'il était attaché à un scandale qui éclata en 1961 avec la faillite frauduleuse du Comptoir national du logement. Cette société de promotion immobilière avait été créée par l'architecte pour réaliser des ensembles de logements dans la région parisienne; sa faillite fut à l'origine d'une affaire à rebondissements, dont un récit nous est donné dans les fameuses Mémoires d'un architecte publiées en 1968: ayant été incarcéré, l'architecte s'évade, séjourne clandestinement en Italie, jusqu'à ce qu'il revienne tout aussi clandestinement en France pour se présenter à son procès... Ces péripéties alimentèrent les rubriques des faits divers, ce qui explique que les réalisations architecturales soient restées méconnues, éclipsées par l'attention exclusivement portée au personnage, celui-ci recevant les qualificatifs les plus divers - magnifique, flamboyant, fastueux, rebelle, paria, moine, ermite, escroc, etc. Bientôt, le temps vint de reconsidérer l'oeuvre , lorsque le scandale s'était éloigné et que restaient les bâtiments. Mais les difficultés demeuraient cependant.
La première difficulté est inhérente au fait que Pouillon lui-même n'a pas pris la peine de léguer à la postérité des documents sur ses travaux, comme s'il avait considéré que l'architecture a pour seule fin d'exister au travers de bâtiments construits, dignes d'être conservés et de défier le temps. C'est dans cette optique que Pouillon s'identifie à un maître d'oeuvre, et plus précisément au maître d'oeuvre du Moyen Âge, qu'il incarne dans son roman Les Pierres sauvages et auquel il rend hommage en consacrant des publications luxueuses aux abbayes cisterciennes provençales de Sénanque, Silvacane et Le Thoronet et aux ruines des Baux-de-Provence.
La seconde difficulté est que Pouillon est l'auteur d'une oeuvre paradoxale. En effet, entre 1945 et 1961, il conçoit de nombreux édifices, principalement en France et en Algérie, sans chercher à suivre des principes habituellement reconnus comme modernes. Sa seule préoccupation est de réaliser des ensembles architecturaux d'une grande force visuelle et d'une solidité exceptionnelle, tant par les matériaux employés - notamment la pierre massive -, que par le dessin d'espaces clairement délimités, souvent réguliers et symétriques. Il emprunte ainsi une voie „française“ de conception du plan, dont l'une des dernières illustrations majeures avait été donnée par Auguste Perret. A celui-ci, Pouillon voue d'ailleurs une admiration sans réserve, depuis qu'il lui fut associé pour la reconstruction du Vieux-Port de Marseille (1948-1955), première grande opération qui signe le destin futur de l'architecte.
Par rapport à ce qui vient d'être dit, rien d'étonnant à ce que, pendant longtemps, l'architecture de Pouillon ait été qualifiée d'anachronique. Pour la façade reconstruite du Vieux-Port de Marseille, les réalisations d'Aix-en-Provence, un ensemble comme les „200 colonnes“ de Climat-de-France à Alger ou les opérations de Pantin, Montrouge, Boulogne-Billancourt ou Meudon-la-Forêt, les choix sont nettement affirmés: choix de figures „fermées“ pour des ensembles de logements qui donnent lieu à des suites d'espaces intelligibles; choix de la pierre comme matériau privilégié de construction et méfiance à l'égard du béton „brut“ ou de la préfabrication „lourde“; choix d'ordonnances verticales pour définir l'architecture même des bâtiments. De ces trois choix principaux et coordonnés résulte un langage architectural singulier correspondant à une conception architecturale et urbaine d'une autre modernité.
Le choix de figures fermées
Après la Seconde Guerre mondiale, en Europe, beaucoup des grandes opérations de construction de logements fabriquent ce que l'on peut nommer un ordre ouvert, les bâtiments s'orientant selon des principes „héliothermiques“, c'est-à-dire par rapport à la course du soleil. Il n’en est pas de même des réalisations de Pouillon. Les dispositions de ses ensembles d’habitations peuvent en effet être regardées comme antinomiques de l’ordre ouvert. Toujours, Pouillon a rappelé sa prédilection pour des formes analogiquement semblables à des places et des cours. Ainsi, lorsqu’il veut apporter sa pierre à la connaissance de la ville, c’est à la qualité de ses espaces publics qu’il s’intéresse, à la qualité architecturale et urbaine des places, des cours et des mails d’Aix-en-Provence où il vécut plusieurs années. En rassemblant, dans le grand recueil Ordonnances édité en 1953, les relevés qu’il a fait faire à des étudiants, il tient à préciser ce qui est pour lui une conviction et lui tient déjà lieu de doctrine: „L’architecte ne peut compter que sur lui-même pour organiser un espace. Il faut que chaque oeuvre réalisée soit, en elle-même, une composition terminée. Celui qui prend la suite le fera dans le même esprit. Prévoir une ville, ne peut pas se faire seulement en plan: il faut savoir imaginer les architectures dans leurs moindres détails. (...) Les grands mérites des tracés du XVIIe et du XVIIIe siècle, étaient de ne concevoir qu’en rapport d’une architecture établie. La forme et l’aspect des bâtiments définissaient le tracé. Il était facile, à cette époque, d’installer un site urbain. L’urbanisme était l’établissement de l’Architecture.“
Pour que l’urbanisme soit l’établissement de l’architecture, et que le modèle des places, des cours ou des mails soit toujours valide, tout en nécessitant cependant des adaptations et des réinterprétations, pour que les espaces puissent se fermer, mais le plus souvent sans se clore complètement, il faut que Pouillon n’ait pas le souci exclusif de l’orientation solaire. Il faut qu’il ait, à l’occasion de chaque projet, le souci de concevoir „une composition terminée“, c’est-à-dire une composition qui ait sa propre individualité et intégrité, qui se replie sur ce qu'il nomme son „paysage intérieur“.
Le choix de la pierre
Le choix de la pierre, lui, nécessite qu’elle soit disponible pour les chantiers, et bientôt, lorsque ceux-ci prennent de l’ampleur, le besoin ne peut pas être satisfait par des carrières encore artisanalement équipées. Pouillon doit en quelque sorte veiller à l’approvisionnement de ses opérations et, pour ce faire, il s’appuie initialement sur un de ses amis, propriétaire des carrières de Fonvieille près d'Avignon, qui a mis au point des machines d’extraction et de taille efficaces. C’est avec cette pierre de Fonvieille qu’il construit plusieurs de ses grandes opérations, à Aix-en-Provence et Marseille, mais aussi à Alger et dans la région parisienne.
Le choix de la pierre donne lieu à plusieurs modes de mise en oeuvre et s’accompagne de recherches techniques complémentaires. Dans l’ensemble de la Tourette à Marseille (1948-1953), par exemple, ou bien les murs sont de pierres massives appareillées, ou bien des plaques de pierre dure de trois à cinq centimètres d’épaisseur servent de coffrages pour des parois de béton sans armature: ce que Pouillon nomme lui-même le système de la „pierre banchée“ . A Alger, pour les trois opérations qu'il construit entre 1953 et 1957, Pouillon fait transporter des pierres par bateau depuis Marseille; elles ont été façonnées à la taille qui est la leur pour le chantier: en quelque sorte des pierres „préfabriquées“, aux dimensions imposantes, par exemple des cubes de un mètre d’arête pour les assises qui forment les deux cents colonnes de la grande cour de Climat-de-France (1954-1957). Une expérience identique est renouvelée à Meudon-la-Forêt (1957-1962), les photographies du début du chantier nous montrant des amoncellements de pierres qui formeront directement les murs ou les piles verticales colossales des hauts bâtiments. A Pantin (1955-1957) et à Montrouge (1955-1958), les mises en oeuvres sont semblables, mais les dimensions plus modestes, tandis qu’au Point-du-Jour à Boulogne-Billancourt (1957-1963) les bâtiments verticaux nécessitent des murs pignons en béton armé, qui sont revêtus de plaques de pierre dure.
Dans la plupart des cas ici évoqués, la pierre appareillée conserve une texture rugueuse, des traces de découpe sont encore quelquefois visibles, les joints de ciment ne sont pas creusés, les éléments de modénature sont réduits au minimum sinon inexistants. La surface est exaltée; c’est ce que fait dire Pouillon au héros de son roman Les Pierres sauvages: „(...) j’ai su, peu après mon arrivée (sur la chantier), que ces pierres seraient traitées grossièrement et posées finement. Comment t’expliquer que la beauté des murs va dépendre de cette sensation (...) ?“
Le choix de l'ordonnance
La travée est mesure et répétition; elle définit et rythme le tracé d'ensemble. Corrélativement, la travée est expression de la construction, colonnes ou pilastres accentuant la verticalité et exprimant la descente de charge.
La travée a donc à voir avec la „tectonique“ du bâtiment, et non pas avec la „vérité“ de la construction. L’écart est important, crucial même pour apprécier l’architecture de Pouillon. Si nous prenons l’exemple de Meudon-la-Forêt, nous voyons ainsi que les bâtiments verticaux sont dotés de piles colossales de pierre, régulièrement espacées, mais des piles qui n’ont pas de fonction porteuse – les planchers ne reposent pas sur elles. Pouillon parle à leur sujet d’un „paravent“ , mais un paravent qui exprime la solidité de l’édifice. Si nous prenons l’exemple de Pantin ou de Montrouge, les façades ordonnancées expriment elles aussi la tectonique du bâtiment : elles alternent régulièrement des pilastres qui représentent une ossature, et des panneaux de plaques de marbre rouge qui sont des remplissages - à l’instar d’un bâtiment „classique“ ou des oeuvres du Perret des années trente -. Dans tous les cas, la verticalité est intensifiée, ce qui explique que Pouillon donne toujours la préférence à la fenêtre verticale qui embrasse la hauteur d’un étage – comme le fait Perret dont on connaît le rejet de la fenêtre en longueur -.
Dans l’écart entre expression de la construction et vérité de la construction, c’est-à-dire dans l’écart entre vraisemblance et vérité se logent toutes les problématiques relatives à un langage architectural et à ses déterminants syntaxiques, un langage qui dit explicitement sa dette envers les paradigmes de l’architecture classique et de ses ordonnances. Par là même, dans la période qui nous intéresse , Pouillon ne procède pas à des copies serviles, échappe au néo-classicisme, n’a pas besoin du secours d’images empruntées directement à d’autres édifices ou d’autres monuments. La puissance de l’évocation lui suffit.
La leçon de Pouillon est là, dans sa capacité à lier problématiques urbaines et problématiques architecturales, c’est-à-dire son aptitude à ne jamais dissocier construction, architecture et forme urbaine. Il en résulte des ensembles d’une cohérence et d’une cohésion incontestables. Et des choix définis qui situent une ambition: „un vocabulaire limité donne toujours plus de force à l'expression“.werk, bauen + wohnen, Mo., 2004.03.15
1) Fernand Pouillon, Mémoires d'un architecte, Paris, Editions du Seuil, 1968. Réédition: Paris, Le Livre de Poche, 1973.
2) Le premier hommage rendu à Pouillon fut celui, en 1982, de la Biennale de Venise, à l'occasion de la deuxième exposition internationale d'architecture, „Architettura nei paesi islamici“ (dans le même temps, la Biennale avait aussi rendu hommage à Hassan Fathy, Louis I. Kahn - pour ses projets à Ahmedabad, Islamabad et Dacca - et Le Corbusier - pour ses projets à Alger et Chandigarh -).
3) Une première monographie avait vu le jour l'année de la mort de l'architecte: Bernard Félix Dubor, Fernand Pouillon, Paris, Electa Moniteur, 1986 (édition italienne: Fernand Pouillon. Architetto delle 200 colonne, Milan, Electa, 1987), avec un avant-propos de Bernard Huet et une préface de Jacques Lucan. Après un colloque consacré à Pouillon, qui eut lieu à Marseille en 1996, Jean-Lucien Bonillo a dirigé un second ouvrage synthétique qui mettait en valeur les différents aspects de l'oeuvre: Fernand Pouillon, architecte méditerranéen, Marseille, Editions Imbernon, 2001. Enfin le livre de Jacques Lucan, Fernand Pouillon, architecte. Pantin, Montrouge, Boulogne-Billancourt, Meudon-la-Forêt, Paris, Picard / Editions du Pavillon de l'Arsenal, 2003, accompagnait l'exposition du même nom qui s'est tenue au Pavillon de l'Arsenal à Paris du 2 avril au 15 septembre 2003, avant d'être présentée à l'EPF de Lausanne et à celle de Zurich.
4) Fernand Pouillon, Les Pierres sauvages, Paris, Editions du Seuil, 1964. Réédition de luxe: Paris, Éditions du Jardin de Flore, 1977.
5) Fernand Pouillon, Maître d'oeuvre. Naissance d'une abbaie. En sus les relevés de trois abbaiies cisterciennes sises en Provence: primo Sénanque, secondo Silvacane, ter le Thoronet, Paris, Éditions Fernand De Nobele, 1967.
6) Fernand Pouillon, Les Baux de Provence, Paris, Editions Fernand De Nobele, 1973.
7) Fernand Pouillon, Ordonnances. Hôtels et résidences des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ordonnances des cours et des places. Ensembles harmonieux d'Aix-en-Provence relevés et dessinés par l'atelier de Fernand Pouillon, Aix-en-Provence, Cercle d'étude architecturale, 1953, p.35 (souligné par moi).
8)Fernand Pouillon, Mémoires d'un architecte, op.cit., p.101.
9) Fernand Pouillon, Les Pierres sauvages, op.cit., p.71.
10) Fernand Pouillon, Mémoires d’un architecte, op.cit., p.363.
11) Après le scandale évoqué au début de cet article, Pouillon est interdit d'exercice professionnel en France. Il va en Algérie, qui vient d'accéder à l'indépendance, et commence pour lui une seconde carrière. Celle-ci est d'abord consacrée à la réalisation d'ensembles touristiques, souvent pittoresques, qui n'auront pas la force des ensembles construits entre 1945 et 1961.
12) Fernand Pouillon, Mémoires d’un architecte, op.cit., p.440.
15. März 2004 Jacques Lucan