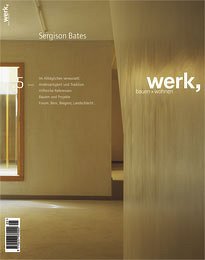Editorial
We experience the buildings by Jonathan Sergison and Stephen Bates as both familiar and alien. Their tendency towards simple forms and a certain sparseness, the care with which they use construction as a means of expression, and their respect for the places that they alter with their interventions - all this paves the way to an understanding of their work. However, the specific context in which they work and from which they draw their inspiration is comparatively alien. For example, in Switzerland we lack a comparable brick culture that is important to much of their work. And the frequently small-scale spatial density of their buildings that we find so fascinating is probably partially derived form the London environment, where the economic situation simply does not permit the sheer size with which we in Switzerland are familiar. Their work bears witness to a certain tenderness in their dealings with everyday, commonplace situations. It appears to have more to do with the maximum, including maximal complexity, than with any kind of minimalism, and certainly than with any rhetoric of crudeness and banality. It is therefore not surprising that although the work of Peter and Alison Smith is cited as a reference, the buildings of the Cambridge School with its unambiguous declaration of architecture as the art of building are mentioned at the same time, including Kettle's Yard with its refined merging of art and everyday life. They will be discussed in this issue, partly because they contribute to an understanding of Sergison Bates, and partly because discoveries of things not so well-known in Switzerland can be made. It is with good reason that Bruno Krucker speaks of realism in his article. Albeit with a certain lightness, but seriously, and above all without irony, this realism affirms the concreteness and conditionality of architecture and derives from it benefit for a kind of architecture that is aware of its history and its autonomy. This sort of realism is constantly of topical interest in the history of architecture; in Switzerland, the last time was at the end of the 1970s, when new forces began to crystallise out of the identity crisis of an increasingly stagnant modernity. „Every art needs the fountain of youth of realism from time to time if it is not to become paralysed“, wrote the great architect and teacher Theodor Fischer in 1918. This would also appear to be worthy of consideration today, when a certain perfectionism has become routine, when different formalisms compete for attention without entering into competition with one another, and when would-be utopian projects cast doubt upon themselves through their latent irony even before they seriously dream about a better world. Against this background, the work of Sergison Bates takes on an altogether different aspect: more commonplace and modest, but also more authentic.
The editors
Inhalt
Thema
Bruno Krucker
Im Alltäglichen verwurzelt | Bemerkungen zur Architektur von Jonathan Sergison und Stephen Bates
Jonathan Sergison
Ausblicke
Irina Davidovici
Andersartigkeit und Tradition | Zur Genealogie der Differenz in der modernen britischen Architektur
Jonathan Sergison und Stephen Bates
Hilfreiche Referenzen
Jonathan Sergison und Stephen Bates
4 Projekte:
Sanierung und Erweiterung mit Mischnutzung, Wandsworth, Londen;
Studiohaus, Bethnal Green, Lond0n;
Royal Arsenal Masterplan, Woolwich, London;
Das Kulturgeschichtliche Museum von Bornholm, Dänemark
Biografie, Projekte 1996 -2005, Bibliografie
Forum
Kolumne:Christina von Braun
Wettbewerb: Internationaler Wettbewerb für ein
neues Musée cantonal des Beaux-Arts in Lausanne
Texte original français
EFH: Haus Binswanger,Landschlacht,von Beat Consoni
Bauten: Atelierhaus Huber in Emmenbrücke, von Graser Architekten AG, Zürich
Bauten: Zweifamilienhaus «Faraday » in Bern, von
Thomas Jomini architecture workshop, Bernund
Jomini &Zimmermann Architekten,Burgdorf
Ausstellung und Katalog «Konstruktive Provokation
» zur Vorarlberger Architekturszene im Kunsthaus
Bregenz
bauen +rechten
Architekturausstellungen | Veranstaltungen |
Wettbewerbe| Neuerscheinungen | Produkte
werk-Material
Graser Architekten AG, Zürich: Atelierhaus Huber, Emmenbrücke
Thomas Jomini architecture workshop, Bern und Jomini & Zimmermann
architekten, Burgdorf: Zweifamilienhaus «Faraday », Bern
Le nouveau Musée des Beaux-Arts à Lausanne
Le musée cantonal des Beaux-Arts se situe actuellement dans le palais de Rumine au centre de Lausanne. De nombreux problèmes sont liés à sa localisation: accès difficiles, espaces d'exposition trop étroits, surfaces de stockage obsolètes et normes de sécurité inadéquates. De plus le rôle du musée a évolué, c'est devenu un lieu de connaissance et de conservation, mais aussi d'échange et d'apprentissage où les sens sont mis en éveille. Jadis réservé à une élite, l'art est aujourd'hui un outil indispensable dans la propagation des connaissances culturelles. Les résultats du concours international à deux degrés soulèvent la question du fonctionnement interne et de l'attrait architectural d'un nouveau musée qui désire s'adresser à un large public.
Un site ambigu Avant l'organisation du concours pour le nouveau Musée des Beaux-Arts, aussi nommé nMBA, il a longtemps été question de son implantation. Après l'analyse du potentiel de plusieurs emplacements dans et autour de Lausanne, le site de Bellerive près du port historique d'Ouchy au bord du lac Léman a été retenu pour ses qualités d'accès, de visibilité, de place et de rentabilité. La parcelle est une vaste étendue de forme trapézoïdale se situant sur une partie du lac remblayée artificiellement à l'occasion de l'Exposition nationale de 1964. Résidu de terre entre ville et lac, zone industrielle et de détente, ce terrain vague réclame une affectation qui revalorise le lieu. Le périmètre de construction est limité par la place des fêtes de Bellerive, une zone industrielle abritant un chantier naval, une piscine avec un vaste parc et le lac s'ouvrant à 180° sur le panorama grandiose des Alpes. Les 9 projets retenus pour le second degré ont été sélectionnés parmi plus de 250 bureaux provenant de 13 pays différents.
Le concours Quatre projets retenus pour le second degré proposent un bâtiment disposé perpendiculairement aux directions principales du site. Le musée s'adosse à la zone industrielle afin de créer une place avec vue sur les Alpes en guise d'accès. Ce positionnement a plusieurs atouts: il crée des espaces extérieurs riches qui se dégagent sur le panorama sans prétériter les vues, sépare les accès publics, privés ou de livraison, hiérarchise les espaces menant progressivement de l'extérieur à l'intérieur du bâtiment, joue avec l'image représentative du musée et offre une séparation claire entre les espaces d'exposition et de travail dont dépend le fonctionnement du musée. L'implication et la cohérence des rapports entre le bâtiment et le site, en particulier avec le plan d'eau du lac et le panorama, semblent avoir défini le classement. Comme pour faire comprendre la réflexion ayant eu lieu durant le jugement, l'exposition des projets retenus trouve son épilogue avec la présentation du projet lauréat des jeunes architectes zurichois Barrel Wülser Kräutler.
Les approches Le projet du bureau Richter et Dahl Rocha, obtenant le 5e rang, propose un bâtiment dont le principe et l'esthétique rappelle un pont. Le volume contenant les salles d'exposition est porté par deux piles qui permettent une organisation libre et flexible du rez-de-chaussée. Les extrémités du volume s'ouvrent sur l'entourage du musée. Côté ville, le contenu du musée se dévoile comme à travers une large vitrine et attire le visiteur. Le bureau Luscher Architectes, classée au 4e rang, cherche par deux pans de mur décalés à limiter l'espace devant le musée et à masquer la zone industrielle. Le visiteur pénètre à l'intérieur du bâtiment par une rampe qui se faufile dans l'interstice crée par le chevauchement des deux murs. Les espaces d'expositions s'organisent sur un niveau, de part et d'autre du foyer, et s'orientent sur le panorama par d'énormes baies vitrées. Des rampes transversales marquent le passage de chaque salle d'exposition et mènent ainsi à la découverte des ¦uvres d'art. La proposition du consortium Kagan + Lopez & Périnet-Marquet, décrochant le 3e rang, allie horizontalité et verticalité. L'exposition temporaire se développe côté ville sur un étage et l'exposition permanente s'organise sur trois niveaux regroupés en une entité indépendante. La rencontre des deux volumes ainsi qu'un bassin affirme la présence du bâtiment vers le lac. La richesse des cheminements internes et l'apport en lumière naturelle varié modifie l'identité de chaque espace d'exposition et offre aux ¦uvres une mise en valeur idéale. Le projet des bureaux Localarchitecture & Mondada, récompensé par le 2e rang, remodèle le remblai artificiel de la parcelle en implantant le musée comme s'il s'agissait d'un éperon rocheux sortant de l'eau. La place devant le musée disparaît progressivement dans le lac afin d'augmenter la cohabitation entre le bâtiment et son environnement. Les ouvertures et les espaces de circulation, munis de galeries reliant les salles d'expositions disposées en enfilade, semblent avoir été creusés dans le bâtiment par l'érosion.
Ying Yang Le projet lauréat des architectes Barrel Wülser Kräutler donne une âme au lieu et s'approprie son environnement en lui conférant une identité nouvelle. Le bâtiment ne comporte aucun angle droit, c'est un polygone sobre a cinq faces irrégulières. Le musée, au revêtement claire contrastant avec l'étendue foncée du lac, est placé au contraire des autres projets primés à l'extrémité de la parcelle, à la limite entre eau et terre. Comme posé sur un promontoire, le musée attire le regard du visiteur depuis la ville et cadre les différentes perspectives sans les masquer. L'accès par une longue rampe en pente douce, un bras tendu vers le visiteur, est un appel à pénétrer dans le musée. Le bâtiment plonge ensuite de manière décidée dans l'eau et dynamise l'étendue plate du lac qui se dégage à ses pieds. Le musée est une suite de promenades, de l'extérieur vers l'intérieur tout d'abord et en son sein ensuite. Les vues et la lumière guident le visiteur à travers le musée et l'oriente, tour à tour sur le lac, la ville, les rives, l'espace vert de la piscine et le chantier naval. C'est une scénographie réfléchie qui met en valeur le bâtiment, ses espaces, ses richesses et son environnement. L'entrée par un espace entièrement vitré se développant sur deux étages est constituée d'une galerie, où se trouve l'accueil et les vestiaires, et d'un café-restaurant en contre-bas. Le mouvement initial en direction du lac est primordial car il contraint le visiteur à se retourner de 180°, autrement dit à se séparer du panorama majestueux qu'il a devant les yeux, avant d'accéder aux salles d'exposition. Cette entrée est le début d'un cheminement en spiral qui traverse le musée et ses expositions suivant le principe du Ying Yang. Le foyer offre un point de vue surélevé sur la ville et sert de vitrine au musée. A partir de cet endroit les chemins se séparent entre les expositions permanentes et temporaires. Les deux salles présentent une spatialité riche et fluctuante donnée par la forme polygonale du bâtiment et accentuée par une couche intermédiaire traitée à la manière d'un paravent plié contenant les circulations verticales. Un escalier où les visiteurs se croisent relie les salles basses du premier étage aux salles hautes baignées de lumière zénithale. Le cheminement en spiral trouve toute sa signification dans l'organisation en quinconce des espaces d'exposition. Chaque salle s'ouvre sur le panorama à son extrémité et s'approprie une identité, une orientation et des éclairages lui étant propre. Les quatre salles d'expositions peuvent fonctionner de manière isolée ou conjointe offrant une flexibilité et une diversité dans l'organisation des expositions et la mise en valeur des d'¦uvres d'art.
A l'avenir... Le concours pour le nMBA a permis de constater le potentiel du site de Bellerive à la fois fragile et grandiose. La réalisation est maintenant une affaire de patience. L'inauguration du nMBA est annoncée pour 2010, mais de nombreuses discussions, concernant le site retenu pour le concours, l'adaptation du plan de zones et le budget de construction de 53 millions, risque de prendre du temps. D'ores et déjà une certitude se cristallise. Le musée desBeaux-Arts désire acquérir de nouvelles ¦uvres, assurer la pérennité de ses collections et dynamiser son image auprès du public. La force tranquille du projet lauréat est un outil indispensable à la réussite de ces buts qui serviront à promouvoir le patrimoine culturel du musée et à étoffer l'offre touristique de la ville de Lausanne.werk, bauen + wohnen, Fr., 2005.05.06
06. Mai 2005 Yves Dreier