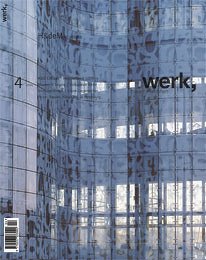Editorial
"People who live at the same time are not actually contemporaries owing to their different ages, origins, education and socialisation. This always leads to overlapping of different systems of perception […]", says Alain Corbin, with whom we talked in Paris recently (see p. XY). This statement is not new, but it is informative and well worth thinking about if we consider it in the context of our everyday experiences in environments that are not possessed of definite and sustainable dimensions. Our ambience changes, we change it, and we change ourselves. Young people live at the same time as the elderly, the early work of the former appears parallel to the late work of the latter, as Wilhelm Pinder formulated it for the history of art in his book „Das Problem der Generation“ (1926). This cultural and historical phenomenon is full of tensions. It is the breeding ground for all kinds of discussions that arise when different experiences and judgements clash.
Three contributions in this issue are concerned with buildings in the new German states. The former GDR, virtually a symbol of the non-permanent greatness of living spaces, has merged with the Federal Republic, and the working class and farming state is now no more than an historical episode. What remains are people, with their experiences and memories, in a changed political, economic and social environment, and the landscape, towns and buildings in varying states of repair or disrepair, second-hand and obsolete phenomena, loved and hated at one and the same time. Is this, too, a piece of homeland? Seen from outside, this would appear to be inevitable.
As we lived through the poignant fall of the Wall, we did not yet suspect that its disappearance in Germany, and above all in „old-new“ Berlin, would in many ways prove to be a breeding ground for ideological behaviour that aimed at the brash and impatient eradication of recent history. The fact that such conduct applies not only to the self-image of two generations, but also to their architectural legacy, is obvious enough. The Palast der Republik in Berlin is emblematic of this. As a disembowelled ruin now purged of asbestos, it is endowed with a multi-facetted symbolism: some people wish to dispose of it with once and for all, and others wish to see it looked upon unsentimentally as an historical witness. A new generation is using the palace for many different functions, thereby setting an example that will be understood well beyond the borders of Berlin. What is needed is composure and open-mindedness. The primary protagonists are the so-called „interim users“. Corbin's overlapping of systems of perception is more than a theory, and the planned demolition of the Berlin palace is more than a metaphor for an indecorous way of dealing with history.
The editors
Inhalt
Editorial
H&deM et cetera (d) | H&deM et cetera (f) | H&deM et cetera (e)
Thema
Sabine von Fischer
Lesewolke | Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum in Cottbus, von Herzog & de Meuron
Sylvain Malfroy
Zwischen Natur und Kunst | Das Heinzkraftwerk Salzburg Mitte von Bétrix & Consolascio + Eric Maier
Texte original français
Andreas Ruby
Möglichkeitsräume der Kunst | Zwei Ausstellungsbauten in Leipzig: das Museum der Bildenden Künste, von Hufnagel Pütz Rafaelian, Berlin und die Galerie für Zeitgenössische Kunst, von AS-IF, Berlin-Wien
Wolfgang Kil
Chronik eines angekündigten Todes | ...Berlin, Palast der Republik
Alain Corbin, Philippe Rahm
Sinnlichkeit, Geschichte, Architektur | Notate eines Gespräches vom 11.1.2005 in Paris
Johannes Stoffler
Grüne Gegenwelten | Natur als Zivilisationskritik im Werk Gustav Ammanns und Richard Neutras
Forum
Kolumne: Wolfgang Ullrich
EFH: Einfamilienhaus in Neuchâtel, von Frund Gallina Rey Architekten
Bücher: Deutschlandschaft
Wettbewerb: Studienauftrag Neues Stadt-Casino Basel
Innenarchitektur: Die Erneuerung des Gemeinderatssaals von Lugano, von Gianfranco Rossi und Claudio Cavadini
Testo originale italiano
Bauten: Büro 3/Cuttat, Hafen, Loretz: Wellnessanlage als Hallenbaderweiterung, Sedrun
Bauten: Fournier-Maccagnan Architekten: Hallenbad in Bassins
Bauten: Robert Maillart in St. Petersburg
Bauten: Glasfassaden in der rumänischen Architektur
bauen + rechten: Grenzen des Sonderrechts im Stockwerkeigentum
Ausstellungen Veranstaltungen Wettbewerbe Neuerscheinungen Produkte
werk-Material
Büro 3/Cuttat, Hafen, Loretz, Zürich: Wellnessanlage als Hallenbaderweiterung, Sedrun GR
Fournier-Maccagnan, Bex: Piscine scolaire et publique,
Bassins VD
Entre nature et artifice
La première intervention de l’agence zurichoise sur le site de la centrale thermo-électrique1 de Salzburg-Mitte remonte à 1986. Il s’agissait alors de donner forme architecturale et urbaine à la nouvelle installation de désulfurisation2 des fumées. Ce projet était emblématique de deux orientations majeures de la politique municipale de Salzburg dès le milieu des années 1980 : d’une part, la mise en œuvre d’une politique énergétique respectueuse de l’environnement, tenant compte en l’occurrence de normes rigoureuses de qualité de l’air, et d’autre part, l’instauration de mesures destinées à promouvoir la qualité architecturale des constructions (y compris celle des infrastructures urbaines), à travers la mise sur pied d’un cercle de qualité3 et l’organisation systématique de concours largement ouverts internationalement. La reconstruction de la halle des chaudières et des turbines, achevée en 2003, met provisoirement fin à un cycle de plus de quinze ans de travaux, au cours duquel toutes les composantes techniques du site ont été successivement renouvelées. Partenaires de ce long processus, dont l’ensemble des étapes ne leur était pas connu d’emblée, les architectes ont été amenés à reprendre sans cesse le dialogue avec leurs propres projets. Comment maintenir la valeur de ce qui a été fait alors que l’expérience accumulée avec le passage du temps renouvelle sans cesse l’inspiration ?
Seule l’implantation dans la ville n’a pas changé
En principe, au cours de sa croissance, une ville repousse périodiquement à sa périphérie ses installations de fourniture d’énergie (usines à gaz, usines électriques), mais aussi les autres équipements encombrants (les abattoirs, les entrepôts du commerce de gros, les incinérateurs à ordures4) qui coexistent difficilement avec le tissu résidentiel et tertiaire5 en expansion. On observe ainsi une migration centrifuge de ces infrastructures, lesquelles, en changeant d’implantation, adaptent du même coup leur type constructif à l’évolution des techniques et des modes d’organisation de la production.i Les friches6 laissées vacantes dans le tissu urbain se referment ensuite plus ou moins rapidement au gré de la pression spéculative. Dans le cas présent, un cycle de substitution a bien eu lieu dans les dernières décennies du XIXème siècle, lorsque la première usine électrique est venue remplacer les anciens abattoirs, aux portes de la ville. Mais l’affectation de cette aire s’est trouvée ensuite durablement fixée dès 1956, lorsqu’une centrale de chauffage à distance est venue compléter l’installation. En effet, à la différence de l’électricité, la chaleur se transporte mal. Il faut la produire à proximité de là où elle est consommée, en l’occurrence et actuellement quelque 27'000 ménages (127 MW). Tout le processus d’augmentation de performance des installations pour faire face à la fois à la croissance de la demande, à l’obsolescence technique, mais aussi aux normes toujours plus nombreuses et contraignantes en matière de sécurité et de restriction des nuisances (environnementales, sonores, visuelles), a dû être maîtrisé sur place, dans les limites de la même parcelle, sans aucune possibilité d’extension. Le défi était de taille dans la mesure où le site, autrefois situé sur le glacis des fortifications baroques, est aujourd’hui confiné à l’intérieur de la ville dense, à mi-chemin entre le quartier de la gare et la vieille ville, bien en vue sur la rive droite de la Salzach.ii Les opérations se sont succédé par rocades. Toutes les composantes de l’usine ont été progressivement remplacées en un laps de temps relativement court, sans interruption de l’exploitation. Ce mélange de dynamisme (constante métamorphose des installations) et de stabilité (localisation fixe) incite à accueillir avec circonspection l’idée que la multiplication des réseaux tend à fluidifier l’espace urbainiii : certains nœuds, au contraire, paraissent vouloir se cristalliser comme autant d’ « éléments premiers » de la villeiv, au même titre que les monuments et les singularités de la topographie. On verra que cette seconde analogie inspire directement la dernière intervention de Bétrix&Consolascio à Salzburg-Mitte.
Des personnages en quête d’auteur7
À aucun moment, l’îlot urbain saturé par les divers composants fonctionnels de cette usine n’a pu être envisagé dans son unité, si ce n’est lors de la « dernière » étape (sait-on jamais si et quand le cycle des renouvellements connaîtra une pause plus ou moins prolongée ?). Chaque nouvelle intervention est venue combler un vide existant, subissant fortement les contraintes de son entourage, avant que de nouvelles démolitions ne créent la place pour l’intervention suivante. D’étape en étape, le moule dans lequel chaque volume a pris forme a été immédiatement cassé pour permettre le bourgeonnement d’un nouvel organe. Conditionnée par ce caractère fortement séquencé de la planification, la composition de l’ensemble du site présente ainsi un caractère additif, sans pour autant que les éléments additionnés soient liés entre eux par un effet de répétition sérielle : chaque partie apparaît dans une singularité exacerbée (géométries hétérogènes des implantations et des gabarits, relations variées à l’espace extérieur), non pas tant en raison de différences fonctionnelles que de conditions particulières de départ8. La frange Est de l’îlot aligne ainsi, en bordure de la Schwarzstrasse, une série de « personnages » ou d’ « événements » architecturalement bien individualisés : en allant vers le nord, d’abord le tout récent bâtiment d’exploitation (1999-2002), d’allure presque domestique avec ses différents types de vitrages, puis la vénérable installation de désulfurisation de 1987 (amputée de sa cheminée dans le courant de l’an 2000), avec sa carrosserie métallique aux courbes élancées, finalement le bâtiment du transformateur9, le plus urbain de tous, clairement positionné en front de rue avec un rez-de-chaussée accessible au public. Les intervalles qui renforcent actuellement l’autonomie de chacun de ces volumes sont sans doute en sursis, mais même lorsqu’ils seront densifiés, le caractère dominant de ce front oriental de l’îlot restera celui d’une accumulation d’objets singuliers dans un espace quasi scénique.
« Opus rusticum » revisited
Le registre expressif dans lequel s’inscrit la longue halle des machines, sur le front Ouest de l’îlot, en bordure de l’Elisabethkai, est d’une tout autre nature. Non plus une addition de volumes aux physionomies particularisées, mais un unique grand corps unitaire : un monolithe. Non plus une succession d’événements architecturaux, révélatrice de la complexité fonctionnelle de l’installation et du rythme nerveux de l’innovation technique, mais un grand bloc minéral, évocateur d’une temporalité plus géologique qu’historique. Le gabarit, à nouveau conditionné par les préexistences du site et la contrainte du maintien de l’exploitation pendant les travaux, est imposant : 120 m. de longueur, 24 m. de largeur, une hauteur qui s’étage longitudinalement à 16, 21 et 25 m avant de culminer, avec la cheminée de section carrée à 70 m. Conférer une échelle à ces dimensions en complète rupture par rapport aux réalisations précédentes, sur le front opposé de l’îlot, n’était pas la moindre difficulté du projet. La masse considérable de cette halle des machines rendait d’emblée vain tout espoir de la mettre à l’échelle de la ville, d’instaurer par un travail sur les détails un quelconque rapport de continuité dimensionnelle avec le découpage des espaces publics et le grain du tissu résidentiel.
Plus que dans l’articulation du volume ou un soin particulier du détail constructif, la solution a été cherchée dans un effet de matière : une texture minérale aussi brute et grossière que possible. Dans la terminologie de tradition vitruvienne, on aurait qualifié autrefois un tel effet de « rustique »v, aujourd’hui on préfère la référence à l’ « informe »vi. Peu importe, dans les deux cas, ce qui compte, c’est la présence sensible de la matière avant même l’évidence d’un quelconque sens : une sorte d’effacement volontaire du « vernis culturel » pour laisser affleurer la nature dans toute sa puissance. On verra plus loin comment ce choix peut être argumenté.
L’enveloppe est coulée en béton dans des coffrages récupérés10 qui surimposent leur texture écorchée à celle du matériau brut. 8'600 m² de façade quasi sans percements, si ce n’est une longue fente, au troisième niveau pour l’éclairage des locaux de surveillance. L’ouvrage est traité comme un monolithe, non seulement symboliquement, mais aussi constructivement, puisqu’il est réalisé sans joints moyennant une sur-armature11 de 160 kg de ferrements par m3 de béton. Une vraie bête, un monstre ! Sa carapace ne pouvait être trop puissante pour réduire au silence la machinerie lourde et vrombissante logée à l’intérieur. Et pourtant le monstre s’est avéré vulnérable. On est saisi de pitié lorsqu’on apprend qu’une lézarde est venue stigmatiser son visage à la suite d’un accident d’exploitation au printemps 2002. Une crue de la Salzach voisine avait gonflé la nappe phréatique. L’hiver était rigoureux et nécessitait qu’on refasse le plein de combustible. 2200 m³ d’huile lourde ont été chargés à l’extrémité nord du bâtiment alors que celui-ci n’avait pas encore retrouvé son assise normale. La poupe trop lourde n’a pas pu compenser le tassement ponctuel de la proue et le navire s’est fissuré sur toute sa hauteur. (On se souvient qu’en 1925, Le Corbusier avait vérifié à ses dépens les mêmes principes physiques avec sa fameuse Petite Maison de Corseaux, cassée en deux par les variations de niveau du lac Léman. Un bardage de tôle avait été ensuite nécessaire pour garantir l’étanchéité de la construction.)vii
Cet accident passe inaperçu dans une construction que ses concepteurs ont voulue manifestement « trash », que ce soit par l’adjonction dans la masse de particules d’anthracite qui l’assombrissent et lui confèrent avant l’heure la patine de la suie (une suie plus virtuelle que réelle puisque la centrale thermique filtre ses émanations !), que ce soit par la technique de coffrage tout juste mentionnée, ou encore par l’abandon sans protection aux effets des intempéries. D’autres indices confirment encore le caractère délibéré de cette intention expressive comme la prise en compte des moindres contingences géométriques de l’alignement12 en front de quai, intégrées dans l’élévation pour neutraliser tout effet d’abstraction rationnelle. Ou encore le refus, au niveau symbolique ou sémiotique, de toute allusion high-tech au contenu fonctionnel de l’édifice. Le mur fait écran. Il instaure le silence, au propre comme au figuré. Il ne dit rien, il est seulement là : présence minérale brute, artefact sans évidence ou transparence de sa destination fonctionnelle13. Pourquoi cela ?
Le paysage des infrastructures urbaines
Une chose est sûre : si cette construction avait été réalisée sans architectes, le résultat aurait été moins laid ! L’apport des architectes à la conception de ce projet s’avère pour le moins paradoxal, puisqu’on a fait appel à eux précisément pour veiller à la bonne intégration de cet objet difficile dans un environnement sensible. Leur stratégie a consisté à refuser aussi bien d’embellir par des mesures cosmétiques superficielles quelque chose qui n’était pas montrable (les chaudières et turbines abritées dans la halle devaient être enfermées dans une enceinte insonorisante), que de dissimuler au regard cette masse que beaucoup auraient préféré ne pas voir. En revendiquant la « laideur » sauvage de cette grande masse de béton en pleine ville, leur stratégie a consisté à agir sur le statut même de l’objet, à redéfinir son genre, à modifier les catégories au moyen desquelles on classe spontanément les constituants urbains.
Quel genre de construction est une centrale thermo-électrique ? Quelle est sa place dans la ville ? S’agit-il simplement d’une « maison » au contenu un peu particulier, mais d’une maison quand même, susceptible de recevoir des façades et un toit comme les autres maisons dans la ville ? S’agit-il d’une construction à caractère institutionnel comme les écoles, les bibliothèques, les théâtres, les bains publics, les gares ? S’agit-il de ces points de repère monumentaux dans lesquels la société se plaît à exprimer symboliquement les valeurs qui la soudent (l’idée de vie civile, de service public, de partage) et qu’elle localise volontiers en situations centrales. Ou s’agit-il plutôt d’une construction à caractère strictement industriel comme une raffinerie, une minoterie, un haut-fourneau ? Est-on en présence d’un dispositif de production dans lequel le critère déterminant de l’agencement formel concerne essentiellement l’optimisation d’une série d’opérations techniques sur des choses ? Ou encore a-t-on affaire à un programme de type infrastructurel, contribuant au métabolisme de la ville, à la régulation de ses échanges avec le substrat environnemental ? Ces questions ne connaissent pas de réponses définitives. Chaque époque invente son système de classement, opère des déplacements, reclasse différemment ce qu’elle hérite du passé. Il y a des époques (mais aussi des lieux) où l’on construit les parkings en surface, d’autres où on les enterre, des milieux encore au sein desquels on projette les hôpitaux comme des monuments, d’autres où on les bâtit comme des établissements industriels. C’est comme cela que du sens est créé, que des « mondes » (éminemment relatifs) sont instaurés pour tenter de rendre le désordre de quelque manière vivable.viii
Le choix qui a été opéré ici consiste à affirmer très littéralement le caractère infrastructurel de l’édifice dans son rapport à la ville. Les infrastructures forment le socle sur lequel repose tout l’édifice urbain. En assurant l’extraction et le transport des ressources naturelles dont la ville a besoin pour exister et se développer, les infrastructures revêtent un caractère éminemment originaire : elles forment en quelque sorte la « seconde nature » de la ville, après les conditions géomorphologiques et climatiques qu’elle s’est choisies. Le paysage des infrastructures ne met pas en spectacle (comme le font les monuments) les valeurs, les idéaux, les buts communs qui soudent la société, mais les conditions matérielles d’existence dans la dépendance desquelles la ville réussit plus ou moins bien à prospérer. Dans un contexte historique et culturel où la tendance dominante est à la surconsommation de biens et de ressources dont on ne veut pas connaître l’origine ni le coût réel de production, on peut dire que le projet de Bétrix&Consolascio pour la centrale thermo-électrique de Salzburg-Mitte opère un salutaire dévoilement du refoulé : l’énergie, devenue si abstraite dans le vécu quotidien de la population, se trouve ici « rematérialisée »ix.
Belle de nuit
Mais le propos ne s’arrête pas à cette remémoration de l’enracinement naturel de l’infrastructure technique. La centrale thermo-électrique est un dispositif de transformation (d’un combustible fossile en énergie thermique) et, à ce titre, elle ne se satisfait pas d’une expression univoque, voire unilatérale. Il fallait dévoiler aussi le monde d’artifices et l’imaginaire de liberté que ce service industriel rend possible. Ainsi, à la nuit tombée, l’édifice se métamorphose. La puissante matérialité qu’il exhibe de jour se dissout en un insaisissable halo bleuté, sous l’effet d’une série de projecteurs et de rampes lumineuses disposées au pied de la cheminée et sur la terrasse ouest.x Cette scénographie nocturne s’est rapidement taillé sa place parmi les curiosités touristiques de Salzburg et la population locale n’a pas eu de peine à s’approprier cette part magique de l’aménagement.
Ainsi, l’alternance du jour et de la nuit modifie inlassablement l’identité du site : tantôt la matérialité brute du béton, tourmenté par les intempéries, accuse l’(omni)présence du substrat naturel dans lequel la ville puise ses conditions d’existence, tantôt, niant la nuit, la lumière artificielle fait valoir les prouesses de la technique et son potentiel émancipateur. Mais quelles que soient les préférences esthétiques que peuvent susciter l’une ou l’autre de ces images, c’est bien de leur unité que résulte la puissance expressive de cette réalisation architecturale.
Notes :
1) Ces cycles récurrents de migration/substitution des équipements urbains ont été particulièrement bien étudiés par Hans-Peter Bärtschi dans le cas de Zurich : Industrialisierung, Eisenbahnschlachten und Städtebau, Basel, Birkhäuser, 1983, en particulier p. 370-371.
2) Sur l’extension moderne de Salzburg, cf. Christoph Braumann : Stadtplanung in Österreich von 1918 bis 1945 unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Salzburg, Wien, 1986.
3) Elisabeth, Heidenreich : Fließräume. Die Vernetzung von Natur, Raum und Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert, Frankfurt/Main, Campus, 2004.
4) Selon la terminologie proposée en 1966 déjà par Aldo Rossi dans L’Architettura della città, dont la pertinence sort plus que jamais renforcée de la confrontation avec le cas présent.
5) Sur la symbolique de l’opus rusticum et son champ d’application dans la tradition vitruvienne, cf. Georg Germann : Einführung in die Geschichte der Architekturtheorie, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980, p. 112 s.
6) Yves-Alain Bois, Rosalind Kraus : L’informe, Paris, Centre Georges Pompidou, 1996.
7) Le Corbusier : Une petite maison – 1923, Zurich, 1954. Adolphe Stiller : « Une descente sur les lieux : construction et détails techniques de la „petite maison“ », in : Le Corbusier à Genève 1922-1932, projets et réalisations, Lausanne, Payot, 1987, p. 135-142.
8) Nelson Goodman démontre dans Languages of Art, 1968 (trad. française Langages de l’art, Nîmes, Chambon, 1990) comment la description de notre environnement engendre de nouveaux systèmes de classification tout aussi souvent qu’elle se sert des classifications existantes.
9) J’emprunte ici l’injonction de François Dagognet : Rematérialiser, matières et matérialisme, Paris, Vrin, 1985.
10) Le concept d’illumination nocturne a été développé en collaboration avec l’éclairagiste Herward A. Dunkel.werk, bauen + wohnen, Fr., 2005.04.08
08. April 2005 Sylvain Malfroy
verknüpfte Bauwerke
Heizkraftwerk Mitte Neu
La nuova Sala del Consiglio comunale di Lugano
Il 15 giugno 2003 in votazione popolare la Città di Lugano e i suoi Comuni limitrofi hanno deciso di fondersi per dar corpo ad una nuova città, ad una „nuova Lugano“, un agglomerato di quasi 60’000 abitanti le cui strutture politiche sono state definitivamente scelte nelle elezioni del 4 aprile 2004. Un progetto di grande importanza, carico di nuove tensioni e ambizioni, e che – finalmente – accorpora in una sola entità giuridica un territorio da anni urbanisticamente già unitario. Prima conseguenza nell’organizzazione di questa nuova città è l’aumento del numero dei politici che sono alla sua testa, da quelli dell’esecutivo, dove il Municipio è stato portato da 5 a 7 membri, a quelli del legislativo, dove il numero dei Consiglieri Comunali è salito da 50 a 60.
È per far spazio a questo nuovo legislativo che nel Palazzo comunale di Lugano sono stati intrapresi dei lavori di rinnovamento, focalizzati soprattutto nella creazione della nuova Sala del Consiglio comunale. Un lavoro delicato sotto molti aspetti. In primo luogo da quello psicologico: si trattava di smantellare l’arredo del vecchio Consiglio comunale, banchi in legno di castagno risalenti all’Ottocento, silenziosi testimoni di antiche battaglie politiche, e con esso di smantellare testimonianze della storia di un Comune. In secondo luogo, di intervenire all’interno di un edificio culturalmente e architettonicamente importante, monumento dell’architettura neoclassica del XIX secolo, costruito nel 1844 da Giacomo Moraglia. Edificio, va precisato, che è stato a varie riprese sede del Governo cantonale in un periodo nel quale i ticinesi litigavano tra loro e non sapevano mettersi d’accordo in quale luogo situare la capitale del Cantone. La sede era quindi itinerante tra Bellinzona, Locarno e Lugano, e ogni sei anni uomini politici e cose e archivi del Governo venivano traslocati da un luogo all’altro. A Lugano il Palazzo oggi del Municipio era di volta in volta sede governativa o albergo. Una situazione precaria che è durata dal 1814 al 1878, fintanto che finalmente, a fronte dei continui e impegnativi traslochi, si decise di optare per la sede fissa di Bellinzona, da allora capitale del Cantone.
La complessità del progetto di Gianfranco Rossi per la nuova Sala del Consiglio comunale è quindi costituita soprattutto dai vincoli dettati dall’edificio esistente, il cui carattere monumentale obbliga al rispetto delle parti murarie portanti e permette solo interventi all’interno degli spazi esistenti. Non solo, ma l’edificio del Moraglia, posto a poca distanza dal lago, soffre fin dalla sua edificazione di importanti cedimenti dovuti all’affossarsi della parte collocata verso la riva, e tale da comportare oggi un dislivello di metri 1.23 tra la facciata sud e quella nord. Una situazione strutturale quindi delicata, che esige attenzione e cautela ad ogni intervento interno.
Idea fondamentale del progetto è porre in relazione lo spazio interno della nuova Sala del Consiglio comunale con lo spazio esterno di Piazza della Riforma, il più importante luogo della vita cittadina di Lugano, baricentro delle antiche strade del centro storico. Le tre grandi finestre rivolte verso la piazza sono quindi elementi importanti del progetto, dettano anzi la tipologia interna, e ad esse si riferiscono gli assi compositivi dell’intervento architettonico. Qualificato da tre scelte progettuali. La prima è quella di utilizzare l’altezza dello spazio per una composizione su due livelli, con la parte bassa dedicata all’anfiteatro dettato dai 60 banchi dei consiglieri comunali e dal podio della presidenza, mentre in alto sono collocati due palchi triangolari, posti nei due angoli interni, nei quali trovano posto la stampa e il pubblico. La seconda scelta progettuale è quella di creare due opposti luminosi, due modi diversi di prendere e di giocare con la luce. Tre pareti sono infatti rivestite con pannelli in legno naturale, in ciliegio, capaci di dettare toni luminosi soffusi, e di fungere da pareti fonoassorbenti, mentre il quarto lato, verso il quale sono rivolti i consiglieri comunali, è costituito da una parete intonacata trattata con una tinta chiara a stucco lucido, superficie per riflettere e diffondere la luce. Due scelte diverse quindi caratterizzano i limiti spaziali interni, un modo semplice ma raffinato per dettare gerarchie e proporre valori differenti.
La terza scelta progettuale è di creare una grande apertura vetrata tra il corridoio del piano superiore e la sala stessa: un gesto qualificato da raffinati modi costruttivi – come la colonna binata con il capitello dorato – e il cui risultato spaziale è di grande importanza. Da un lato trasforma quello che era un semplice corridoio di passaggio in un atrio vero e proprio, e d’altro lato crea una inaspettata continuità visiva tra questo nuovo atrio, la sala del Consiglio comunale e la Piazza della Riforma che sta al di là delle tre grandi finestre della facciata nord. L’intervento ideato dagli architetti è allora esemplare, perché pur nel rispetto rigoroso delle preesistenze e delle loro specificità storiche riesce a proporre nuovi valori spaziali, ben oltre i confini della semplice routine funzionale. E da cui affiorano i diversi elementi architettonici e costruttivi che vanno a comporre lo spazio, come i banchi e l’arredo della Sala, come la lunga struttura dedicata all’illuminazione, come le finiture accurate che risolvono la ventilazione e l’aria condizionata, come le travi in ferro che reggono i palchi triangolari destinati al pubblico, come il soffitto leggermente voltato e discretamente dipinto. Che raffigura nuvole bianche che percorrono l’azzurro del cielo.werk, bauen + wohnen, Fr., 2005.04.08
08. April 2005 Paolo Fumagalli